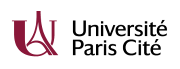Laboratoire d'histoire des théories linguistiques
Présentation
Le laboratoire est le lieu d’élaboration et de diffusion des recherches sur l’histoire des conceptions du langage et des langues. Il couvre de nombreuses aires culturelles et rassemble principalement des linguistes, spécialistes de langues variées (allemand, anglais, arabe, espagnol, français, grec, hébreu, italien, islandais, khaling rai, koyi rai, langues slaves, latin, mayalam, persan, portugais du Brésil, sanskrit, tagalog, tamoul, thulung rai), ainsi que des historiens et des philosophes.
Au plan international, le laboratoire est au coeur d’un dispositif qu’il a contribué à créer et qu’il s’attache à faire vivre et prospérer. Ses principales coopérations sont menées avec l’Allemagne (Univ. de Potsdam), l’Australie (Univ. de Sydney), le Brésil (Univ. de Sao Paulo, de Campinas, Univ. Mac Kenzie), l’Espagne (Univ. de Salamanque, de Barcelone), les états-Unis (Univ. d’Illinois à Urbana Champaign), l’Inde (EFEO, IIT Bombay, IIT Kanpur), l’Italie (Univ. La Sapienza, Univ. de Brescia, de Salerne, de Cosenza, de Palerme, la Scuola Normale de Pise), le Royaume Uni (Univ. de Cambridge, d’Oxford, de Sheffield), la Russie (Académie des Sciences, Univ. de Moscou, Univ. de Saint-Pétersbourg), la Slovénie (Univ. de Novy Sad), l’Ukraine (Univ. de Kharkiv). La revue HEL est l’une des quatre principales revues mondiales dans le domaine avec Historiographia linguistica (John Benjamins), ainsi que les BGS (Münster) et Language & History (Londres).
Il participe aux actions fédératives de recherche suivantes : la Fédération de recherche Typologie et Universaux Linguistiques (TUL) du CNRS ; l’Infrastructure de recherche CORPUS du MESR (Consortium Corpus écrits) ; l’Institut des Humanités de Paris et son Centre d’études de la Traduction ; le Labex Empirical Foundations of Linguistics (EFL).
Thèmes de recherche
Axe 1 – Grammatisation et outillage des langues
(Resp. F. Cinato, A. Lahaussois)
Nous appelons grammatisation des langues (à la suite des travaux de S. Auroux et du laboratoire), le processus historique à travers lequel celles-ci sont équipées d’outils linguistiques (typiquement les grammaires, les dictionnaires, mais pas seulement) qui contribuent à façonner les représentations linguistiques des locuteurs de ces langues, les exposent (dans l’enseignement par exemple) à des savoirs métalinguistiques, contribuent à élaborer et à institutionnaliser les idiomes nationaux, et par conséquent modifient l’écologie des langues.
1.1. Grammaires étendues (Resp. É. Aussant)
1.2. Lexiques et dictionnaires (Resp. A. Grondeux)
1.3. Histoire des pratiques : écrire, annoter, commenter (Resp. P.-Y. Testenoire)
1.4. Production de ressources (Resp. B. Colombat)
Axe 2. Courants, domaines et théorisations des sciences du langage
(Resp. : Jean-Michel Fortis, Chloé Laplantine)
L’axe 2 regroupe les recherches historiques et réflexives (méta-théoriques) portant sur des configurations théoriques identifiées par leur type d’approche, le domaine d’investigation, un événement significatif ou une figure importante de l’histoire de la linguistique.
2.1. Traditions, champs et courants : aspects historiques (Resp. J.-M. Fortis)
2.2. Traditions, champs et courants : aspects réflexifs (Resp. J.-M. Fortis & C. Laplantine)
2.3. Production de ressources (Resp. : C. Laplantine)
Axe 3 – Écritures de l’histoire des sciences du langage : catégories, convergences, commensurabilités
(Resp. É. Aussant, P-Y Testenoire)
Sur différents objets historiques et différentes périodes, l’axe 3 rassemble des projets qui visent à travailler plusieurs questions méthodologiques récurrentes dans l’activité du laboratoire. Il peut s’agir de catégories historiographiques (horizons de projection, modélisation, etc.) ; il s’agit aussi de plusieurs exemples de convergences, de mises en relations entre domaines ou champs de savoir qui ont pu jouer un rôle structurant dans l’histoire récente comme dans l’histoire ancienne des sciences du langage (psychologie, logique, théologie, etc.). Mais l’historien peut (doit ?) interroger et faire dialoguer des phénomènes différents et cependant comparables. C’est cette commensurabilité qui sera mise à l’épreuve à propos d’espaces culturels et temporels souvent éloignés et parfois sans influence attestée ou reconnue (pratiques glossographiques occidentales et extrême-orientales, rapports entre logique et langage en occident et dans le monde bouddhique, etc.).
3.1. Catégories historiographiques et écriture de l’histoire des sciences du langage (Resp. P-Y. Testenoire)
3.2. Connexions interdisciplinaires (Resp. D. Samain)
3.3. Questions de comparaison (entre pratiques et/ou théories distantes dans l’espace et/ou le temps) (Resp. F. Cinato)
3.4. Production de ressources (Resp. É. Aussant)
Autres contacts
U.F.R. Linguistique (UFRL)
Bâtiment Olympe-de-Gouges
8 place Paul-Ricoeur
75013 PARIS