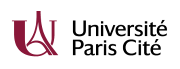Laboratoire Dynamiques Sociales et Recomposition des Espaces
Présentation
L’UMR LADYSS "Dynamiques sociales et recomposition des espaces" est un laboratoire pluridisciplinaire associant deux disciplines principales, la géographie et la sociologie et quatre sites. Elle est contractualisée avec quatre Universités – Paris 1, Paris 7, Paris 8 et Paris 10 et rattachée à deux sections du Comité National de la Recherche Scientifique, la section 39, "Espaces, Territoires, Sociétés" (section principale), et la section 36 "Normes et Règles".
Sa direction est assurée depuis le 1er janvier 2014 par une géographe, Nathalie BLANC et sa direction adjointe par un économiste Thomas LAMARCHE et une géographe, Nathalie LEMARCHAND.
Le laboratoire consacre ses travaux à l’étude des processus et formes actuels de recompositions sociales et spatiales en rapport avec la mondialisation et les problèmes d’environnement. Mieux relier ces processus et leurs différentes composantes, en combinant les approches et les points de vue disciplinaires et à travers la confrontation d’analyses menées à différents niveaux et différentes échelles et dans des contextes territoriaux diversifiés, représente l’objectif d’un projet qui s’inscrit d’emblée dans le mouvement de décloisonnement sémantique et thématique qui traverse les sciences sociales.
Sur le plan méthodologique, plusieurs démarches complémentaires sont mobilisées pour appréhender la complexité des interactions en jeu dans les dynamiques étudiées : des études localisées et plutôt qualitatives, privilégiant l’entrée par les acteurs collectifs et individuels, et les rapports entre la matérialité et l’immatérialité des territoires, sans exclusive pour des analyses plus globales et quantitatives mobilisant des catégories d’indicateurs construits à partir des recherches réalisées; le recours à la méthode comparative et le regroupement de chercheurs autour de problématiques et de thématiques bien ciblées permettant le développement de programmes interdisciplinaires.
Pour réaliser son projet, le Ladyss peut se prévaloir de compétences disciplinaires variées (géographie, biogéographie, sociologie, anthropologie, architecture urbanisme, géopolitique, droit, philosophie etc.) et de fortes compétences sur la France et l’Europe, alliées à un large éventail de terrains de recherche (Asie, Maghreb, Brésil etc.), mais aussi d’une longue expérience de recherche dans le champ du rural et de l’urbain et sur des questions liées à l’aménagement.
Thèmes de recherche
Il existe, donc, quatre axes principaux au nouveau projet du LADYSS.
- Le premier concerne la globalisation et la mondialisation : « Recompositions socio-spatiales dans la globalisation ».
- Le deuxième porte sur « Les territoires du quotidien : représentations, pratiques, projets ».
- Le troisième s’intitule « Environnement et développement : vers un nouveau paradigme ? »,
- le quatrième « Enjeux sanitaires et territoires ».
Les équipes de recherche de ces quatre axes sont situées professionnellement sur les sites différents de rattachement et appartiennent également à plusieurs écoles doctorales. Cette diversité d’appartenance est un atout fort dans le projet du LADYSS. En effet, c’est une diversité disciplinaire, institutionnelle, qui somme le laboratoire de ne pas être une collection d’individus aux dépens du collectif. C’est cette diversité qui force à la cohésion scientifique. L’approche transversale « Rapports sciences-sociétés à l’épreuve du terrain » que nous avons décidé de créer répond au souci d’un temps fort dans l’année d’une dynamique collective.
Autres contacts
UFR. Géographie, Histoire, Economie, Société (GHES)
Bâtiment Olympe de Gouges
Place Paul Ricoeur
75013 PARIS