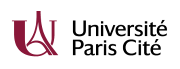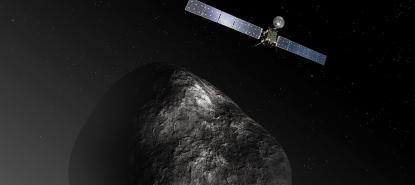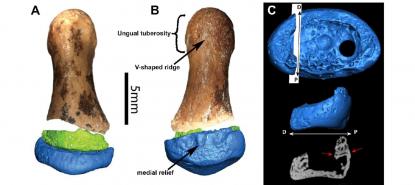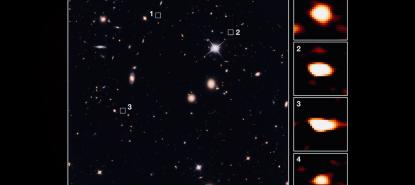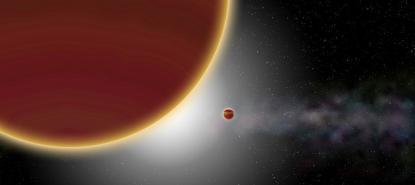Le populisme est-il un risque pour les démocraties ?
Cet article écrit par Federico Tarragoni, Sociologue à l'université Paris Diderot – USPC est publié dans le cadre de la deuxième édition du Festival des idées, qui a eu pour thème « L’amour du risque ». L’événement, organisé par USPC, s'est tenu du 14 au 18 novembre 2017. The Conversation France est partenaire de la journée du 16 novembre intitulée « La journée du risque » qui s'est déroulé à l’Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco).
Le populisme est l’un des concepts les moins maîtrisés et pourtant les plus obstinément présents dans le débat public contemporain. Depuis deux décennies, le mot réapparaît systématiquement dans les médias et dans l’espace politique, malgré les critiques incessantes dont il fait l’objet en tant que catégorie floue, susceptible de s’appliquer à un ensemble trop hétéroclite de phénomènes, d’idéologies ou de mouvements. Dans les vingt dernières années, il a désigné pêle-mêle le Front national et le Front de gauche en France ; la Ligue nord, le berlusconisme et le Mouvement 5 étoiles en Italie ; le Tea Party, Donald Trump et Bernie Sanders aux États-Unis ; et Podemos, Syriza, le FPÖ autrichien, les Vlaams Blok flamands…
Or, quand on l’utilise, on fait plus que simplement désigner. On juge et on met à l’écart. On juge de la « bonne » présence du peuple en démocratie, c’est-à-dire de la bonne quantité de conflit dont la démocratie, tel un système homéostatique, peut s’accommoder sans péricliter. Plus souvent encore, on dénie tout court un droit de cité au conflit en démocratie, car le peuple, que les thuriféraires du populisme semblent vouloir protéger de lui-même pour le renvoyer à son activité paisible d’électeur-consommateur, en vient même à être opposé à la démocratie.
En juxtaposant dans la même classe d’objets des mouvements ou des options idéologiques opposés, des partis et des mouvements sociaux défendant des visions radicalement différentes du peuple, on se livre ainsi à trois opérations indissociables. On discrédite les plus démocratiques d’entre eux à l’aide de l’opprobre touchant les plus réactionnaires ; on valide l’idée d’une indistinction contemporaine entre la « droite » et la « gauche » ; on généralise une « peur du peuple », à savoir une véritable hostilité vis-à-vis de toute critique radicale de la démocratie telle qu’elle est.
C’est pourquoi, derrière les usages contemporains et incontrôlés du populisme, se cache l’une des formes les plus redoutables du mépris pour la démocratie elle-même.
Nouveaux mouvements
Au seuil du XXIe siècle, nous sommes confrontés toutefois à l’émergence dans le monde occidental de nouveaux « mouvements populaires » dont on peine à faire ressortir clairement les revendications démocratiques.
Ces mouvements – le mouvement grec de la « génération des 600 euros » de 2008, les Indignés espagnols, Occupy Wall Street, le mouvement italien des « 99 % », Nuit debout en France – réclament un élargissement de la démocratie en tant qu’espace de droits, de capacités, d’égalité.
Souvent traités de « populistes » à l’image des organisations de gauche qui, dans certains cas, en ont porté les revendications dans l’enceinte institutionnelle (Syriza, Podemos et le Mouvement 5 étoiles), ces mouvements ne posent pas moins une nouvelle centralité du référent « peuple » dans les luttes sociales contemporaines. Le chercheur souhaitant l’analyser se voit ainsi obligé à lever un nombre croissant de malentendus sur le « frère cadet » du peuple dans la sémantique politique, le « populisme ».
Comment faire ? Il faut d’abord distinguer soigneusement « populisme » et « démagogie » : ce dernier terme, depuis Aristote et Platon, décrit efficacement le mauvais usage de la démocratie fondé sur l’abus de la flatterie, de la séduction et de la promesse qui aliène le peuple à lui-même. Pourquoi ne pas l’employer à chaque fois que derrière le « populisme » nous entendons dénoncer une rhétorique des élites qui illusionne le peuple ?
Il reste ensuite à montrer que les traditions idéologiques et historiques dont héritent les mouvements (pour certains d’entre eux totalement fascistes) confondus dans le panier « populiste » n’ont strictement rien à voir, et que rien ne nous autorise à les confondre. Il est relativement aisé de distinguer de la sorte, pour la France contemporaine, le Front national, qui puise ses racines dans le nationalisme autoritaire du début du XXe siècle, et le Front de gauche, plus proche du socialisme jaurésien.
Si le populisme n’est ni une idéologie démagogique, ni une trans-idéologie nationaliste et autoritaire, alors quelle forme prend-il ?
Nous proposons que le populisme puisse être défini comme un mode de mobilisation politique spécifique, proche du plébéïanisme. Il se caractérise par l’apparition de mouvements populaires dénonçant une démocratie dépossédée par les élites (politiques, économiques, financières) et prônant que celle-ci soit élargie de façon égale et effective à tous. Donc, point de populisme sans mouvements populaires. Une telle définition, cohérente avec l’histoire sociologique du phénomène, qui naît au XIXe siècle en Russie (narodnischestvo) et aux États-Unis (People’s Party) et s’institutionnalise au XXe siècle en Amérique latine, permet de faire un usage parcimonieux et rigoureux de ce terme totalement galvaudé dans les médias aujourd’hui. Une deuxième caractéristique, commune à toutes les manifestations historiques du populisme, doit être ajoutée à cette définition : les populismes apparaissent toujours, sous une forme potentiellement révolutionnaire, dans les moments de crise politique du (néo)libéralisme. C’est pourquoi ils se caractérisent par une légitimité de type charismatique entre un porte-parole et des subalternes se sentant exclus de la politique (néo)libérale, et souhaitant se révolter contre celle-ci.
Retour en Amérique latine
Une telle définition ne peut être travaillée qu’à partir du contexte géographique où le populisme s’est institutionnalisé, c’est-à-dire en Amérique latine. De fréquents cycles de « populismes providentiels » comme le péronisme argentin ou le cardénisme mexicain (mouvement créé autour du président Lazaro Cardenas dans les années 30) ont marqué la région. Pensons encore aux derniers mouvements en date avec le « tournant à gauche » des années 2000 au Venezuela, en Bolivie et en Équateur. Ces phénomènes permettent d’étudier les tensions et les contradictions que toute véritable politique populiste engendre.
L’Amérique latine nous montre également que le populisme n’a pas vocation à se stabiliser, et qu’il constitue davantage un mouvement politique de transition entre deux formes de gouvernement : en émergeant sur les ruines d’une politique (néo)libérale devenue excluante et illégitime, il peut faire évoluer la société soit vers une démocratie approfondie, plus riche en droits civiques et sociaux, soit vers une forme d’autoritarisme déguisé.
Les deux chemins, la démocratie radicale et l’autoritarisme, souvent confondus comme une même et unique essence du populisme, n’en sont pas moins deux évolutions possibles de la mobilisation populiste. En ce sens, un populisme « meurt » lorsque le personnalisme du leader charismatique et la domination étatique qui en est solidaire prennent le pas sur l’autonomie des mouvements populaires : c’est ce qui s’est passé, par exemple, dans le Brésil de Getulio Vargas après l’instauration de l’Estado novo mais aussi lors du retour de Perón de son exil espagnol, ou encore dans le Venezuela contemporain de Nicolàs Maduro.
Le populisme, projet modernisateur
Les sociétés latino-américaines étant marquées, dans la foulée du libéralisme post-indépendance du tournant du XXe siècle, par leur statut de « sociétés dépendantes », le populisme y a fait figure de projet modernisateur.
Ce populisme latino-américain dit « classique » s’est ainsi défini à partir de trois objectifs.
Il a permis aux sociétés citées précédemment (et de nombreuses autres dans la région) d’inclure les plus démunis dans le système de production et de distribution, de s’autonomiser par rapport à la condition coloniale et de tendre vers un projet démocratique.
Il n’a pas moins engendré des tensions sur les contre-pouvoirs libéraux des démocraties représentatives en voie de gestation dans le sous-continent, parfois au profit de tendances plébiscitaires ou césaristes, le cas le plus symptomatique d’une véritable conversion fasciste du projet populiste étant l’Estado novo de Vargas.
Cette interprétation du populisme « classique » en Amérique latine ne prend toutefois pas en compte deux éléments : la relation charismatique entre un leader pourvoyeur d’un discours valorisant et une masse d’exclus en quête d’identité politique, comme dans le cas du premier péronisme ou d’Hugo Chávez ; la dialectique entre une organisation populaire émancipée par l’État populiste, et un pouvoir soucieux de la contrôler, en l’« étatisant » progressivement.
Le lieu spécifique de déploiement de cette dialectique est, dans le populisme classique, le syndicat.
De l’hiver des dictatures à un nouveau populisme
La période des populismes classiques s’est éteinte dans le sous-continent dans les années 1970, avec l’« hiver des dictatures » et la marche vers un développement néolibéral globalisé.
Les tensions croissantes produites par ce nouveau modèle ont toutefois débouché sur une résurgence des mouvements populaires.
Le Venezuela d’Hugo Chávez, la Bolivie d’Evo Morales et l’Équateur de Rafael Correa sont les prototypes de cette refondation, sur de nouvelles bases, du modèle populiste continental.
Les nouveaux populismes émergent à partir des contestations sociales croissantes, souvent émeutières, des politiques d’ajustement structurel du FMI (Caracazo vénézuélien du 27 février 1989) ou des politiques néolibérales de prédation des ressources naturelles : c’est le cas des guerres de l’eau et du gaz entre 2000 et 2003 en Bolivie et des mobilisations indigènes contre les multinationales européennes en Équateur.
Leur base sociale n’est plus organisée par le seul mouvement ouvrier, mais par une multitude d’organisations communautaires locales qui, ancrées dans les quartiers populaires (barrios), ont désormais vocation à remplir une fonction hégémonique dans le nouveau système populiste.
Quand peuple rime avec conflit
Un curieux processus se donne alors à voir : l’État, transformé par une idéologie plébéienne progressiste, met en place des dispositifs d’action publique censés démocratiser la société, comme les Conseils communaux au Venezuela, les nouvelles Juntas vecinales en Bolivie et les Conseils citoyens en Équateur. Ces dispositifs, en associant les habitants des quartiers populaires aux décisions publiques les concernant, ont vocation à intégrer et politiser les exclus des anciennes démocraties (néo)libérales.
Mais peuple rime avec conflit : lorsqu’un nouveau peuple démocratique se crée, celui-ci peut se penser souvent contre l’État.
Cette tension, observable en Amérique latine contemporaine, est désormais palpable dans l’Europe d’aujourd’hui. Ici la base sociale interclassiste des nouveaux mouvements sociaux (Indignés espagnols, précaires grecs, mouvement des référendums en Italie, Nuit debout en France), constituée par des classes moyennes en voie de déclassement et par une partie des classes populaires, se politise en réaction à la crise économique des années 2008-09 et à l’érosion pluri-décennale des droits sociaux. Leur slogan devient, comme en Amérique latine avant le tournant à gauche des années 2000, la critique de l’inertie des gouvernements représentatifs, perçus comme une « caste élective ».
Les « cultures politiques » nationales ont évidemment une place prépondérante. Par exemple, le populisme du Mouvement 5 étoiles italien ne peut pas être compris sans faire référence à la tradition « qualunquiste » des années 1940 (née autour du militant Guglielmo Giannini en 1944) et au vide politique laissé par la disparition du Parti communiste italien.
De même, le populisme de Syriza ne peut-il pas être compris sans faire référence aux formes de l’expérience plébéienne en Grèce dans les années 1970, et à la critique profonde du social-libéralisme incarné aujourd'hui par le parti PASOK. Enfin, le populisme de Podemos ne peut pas être dissocié, pour ne prendre que cet aspect, des expériences d’autogestion dans les villes du sud du pays, ayant constitué un terreau favorable de luttes et d’organisation.
Ces spécificités marquent également l’évolution de ces « populismes » une fois au pouvoir : Syriza constitue actuellement un populisme avorté, à cause d’un écart croissant entre la politique étatique et les aspirations des mouvements populaires, lors même que le Mouvement 5 étoiles oscille, dans son projet politique, entre une utopie de la « démocratie électronique » et une utopie de la « démocratie sociale ».
Podemos constitue peut-être, en raison des circulations politiques plus denses entre le modèle latino-américain (systématisé par la philosophie d’Ernesto Laclau) et les jeunes cadres du parti, le populisme le plus « mûr ».
Une démocratie radicale à construire
Podemos semble en revanche être le seul parmi ces mouvements à effectuer une critique interne, et à mettre à l’œuvre une sorte de « populisme pragmatique ». Sa devise devient de plus en plus « Peuple, n’oublie pas de critiquer celui qui parle en ton nom » : ce qui revient à conflictualiser la raison populiste elle-même, en radicalisant les aspirations démocratiques des mouvements populaires, par définition irréalisables dans la politique étatique.
Or si ces populismes constituent un « possible » pour la refondation de la gauche après l’enlisement social-libéral, c’est surtout en raison de leur projection vers une « démocratie radicale » à construire.
Celle-ci se fonde sur la volonté de mettre en place 1) des politiques intégratrices visant à recréer les droits sociaux érodés par le néolibéralisme ; 2) des politiques de participation démocratique se concrétisant sous la forme de jurys citoyens ou de dispositifs de gestion locale des politiques publiques ; 3) des politiques d’inclusion symbolique prenant en charge les demandes de reconnaissance des mouvements populaires.
![]() Le nouveau populisme de gauche qui naît en Europe sous nos yeux ambitionne, en d’autres termes, de reconstruire l’Europe à rebours du libéralisme des accords économiques des années 1950. C’est en subordonnant les politiques économiques communes à un projet politique réellement démocratique que l’on pourra, en ce sens, donner corps à l’utopie européenne tout en contrant les replis fascistes, nationalistes ou souverainistes. Le populisme participe de cette réinvention politique de la démocratie qui, à la condition d’avoir conscience de ses limites internes, peut contribuer à donner sens à notre avenir.
Le nouveau populisme de gauche qui naît en Europe sous nos yeux ambitionne, en d’autres termes, de reconstruire l’Europe à rebours du libéralisme des accords économiques des années 1950. C’est en subordonnant les politiques économiques communes à un projet politique réellement démocratique que l’on pourra, en ce sens, donner corps à l’utopie européenne tout en contrant les replis fascistes, nationalistes ou souverainistes. Le populisme participe de cette réinvention politique de la démocratie qui, à la condition d’avoir conscience de ses limites internes, peut contribuer à donner sens à notre avenir.
La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation.