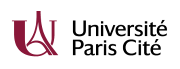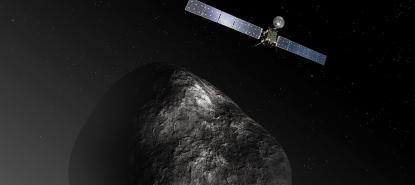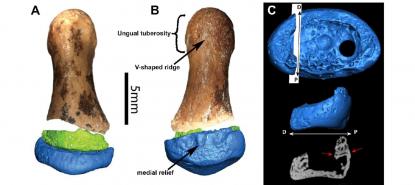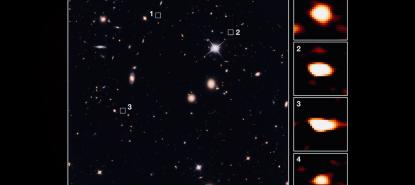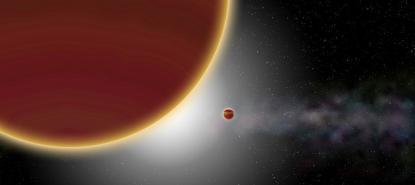Droit au logement, droit à dormir ? Les squatteurs : des acteurs urbains à part entière
L'auteur de cet article, Baptiste Colin, est historien et chercheur associé au laboratoire Identités-Cultures-Territoires de l'université Paris Diderot.
Le mal-logement est régulièrement pointé du doigt. En même temps, selon la dernière étude de la Fédération nationale de l’immobilier, le nombre de logements vacants ne cesse de progresser, notamment dans les petites villes. Ce décalage entre besoins réels des habitants et opportunités est une situation dénoncée dans le 23ᵉ rapport de la Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés, rendu public le 30 janvier dernier.
Des solutions pratiques sont parfois appliquées pour résoudre ce problème : le squattage en est une. L’ouverture d’un squat peut souvent être confondue avec la violation de domicile. Avant de pouvoir squatter, il faut effectivement avoir repéré une cible. Les squatteurs disposent d’équipes de choc, expertes en la matière… Les opérations « coup de poing », ça les connaît.
Souvent les performances et ouvertures de squats sont médiatisées : on pense ainsi en France aux coups d’éclat du collectif Jeudi noir, mais aussi aux nombreuses propriétés vacantes qui peuvent potentiellement abriter des habitants, à Londres comme en Allemagne. Si le marché n’était pas soumis à des contraintes spéculatives complexes, de nombreuses personnes sans domicile en Europe pourraient trouver à se loger.
Certaines actions mettent à jour les scandales sanitaires qui touchent des personnes en grande précarité, très vite affublées de l’étiquette d’un anathème délateur : les « squatteurs ». D’autres encore prennent la forme d’occupations collectives sur des lieux devenus symboles de luttes sociales (la ZAD de Notre-Dame-des-Landes).
Mais au juste, qu’est-ce que « squatter » ?
Le squattage est une opération consistant à l’établissement d’un squat c’est-à-dire à l’appropriation indue d’un local selon des motifs et usages que les occupants déterminent eux-mêmes.
La constance historique dans le recours à cette forme d’action et à ce mode d’utilisation spatiale au visage complexe (ce que démontrent notamment des ouvrages, centrés sur les questions migratoires, ou sur les formes culturelles du phénomène) prouve certainement que les squattages sont inhérents aux problématiques de régulation sociale et de fonctionnement des sociétés contemporaines. L’illégalité des squats, parce qu’ils vont à l’encontre du principe justiciable de la propriété, peut être opposée à la légitimité sur laquelle entend se fonder le squattage.
Réquisitionner les « palais inutiles »
Georges Cochon, le célèbre ouvrier anarchiste réputé à l’origine de la pratique protestataire du squattage, et surtout de la Confédération nationale du logement, l’a déjà compris en 1912.
Dans une lettre ouverte adressée au ministre de l’Intérieur, il réclame la réquisition des monuments, ces « palais inutiles », au profit des « pauvres gens », ce peuple mal logé ou sans logis qui est, de surcroît, prêt à payer.
L’éventuelle légitimité de l’action entreprise s’appuie-t-elle sur les conditions indécentes dans lesquelles une large part de la population vit, exclue des mécanismes d’ascension sociale de la société capitaliste marchande et de l’accès au logement « digne » et « décent » ? Ou relève-t-elle de principes libertaires revendiquant l’autodétermination, par-delà une administration rémunérée et coercitive de l’espace ?
L’opposition entre squats d’« exclus » et squats « contestataires » reflète en fait des configurations très variées.
Aux grands discours des candidats (Nicolas Sarkozy en 2006, annonçant la garantie du « droit à l’hébergement » et des élus (Emmanuel Macron en 2017, promettant de « loger tout le monde dignement ») répondent les images des bidonvilles bel et bien réels, les drames récurrents dans les taudis urbains. D’après une estimation, la France comptait en 2017 près de 570 bidonvilles, regroupant une population de 16000 personnes.
Dormir est un luxe
Au-delà du phénomène migratoire exacerbé par l’ampleur des situations d’exil, les multiplications de campements à grande échelle, la banalisation de la présence de personnes abritées sous des tentes, enveloppées dans les bosquets, estompées sous les ponts, roulées dans la crasse du métro démontrent que dormir est devenu un luxe.
Le mois dernier, l’association Droit au logement (DAL) a voulu faire réquisitionner le Val de Grâce, brisant l’harmonie de Noël en scandant « Un toit c’est un droit », afin de faire résonner les promesses présidentielles.
Chaque nuit, les désignés « SDF » s’approprient un recoin de notre champ de vision. Rassurés sur l’activisme de certains face à la misère d’autres, d’aucuns oublient pour un temps peut-être la crise d’urticaire que leur provoque l’évocation de la ZAD, « zone de non-droit », insupportable fief de squatteurs semblant en panne de perspective de grands soirs révolutionnaires.
Ils oublient la révolte intérieure que leur provoque le feuilleton médiatique des innocents propriétaires lestés par de « vilains squatteurs », aux revendications imbitables, utopies d’un autre monde. Pourtant, toutes ces réalités démontrent que face à la nécessité de dormir, la quiétude polémique des uns ne vaut pas la confortable liberté des autres.
Le squat, lieu de la révolution ?
Le discours squatteur serait « révolutionnaire », « radicalisé ». Les squatteurs n’agiraient qu’à des fins stratégiques de satisfaction individuelle ou de désordre social. Pourtant, ils opèrent une profonde critique politique du principe de l’organisation sociale et proposent, par leurs revendications à vivre autrement, des alternatives aux systèmes traditionnels de production du logement.
À Berlin est lancé le mouvement des Instandbesetzer au début des années 1980, importé à Paris dans la foulée pour mettre en valeur le potentiel constructif du squattage. On retrouve cette vigueur à Lyon, à Amsterdam, à New York, jusqu’à aujourd’hui.
Le mouvement squatteur, c’est un peu de tout cela. Plus précisément, c’est une attention collective, continuellement acharnée, à construire, au-delà du « droit à dormir », les espaces d’une existence individuelle dans l’histoire du logement.
L’histoire des squattages révèle que les squatteurs sont en mesure d’exploiter ce champ des possibles qui s’ouvre dès lors que l’acte de squatter tend à attendrir les défenseurs et entrepreneurs de morale qui, de leur côté, condamnent sans appel une telle transgression.
Autant de squatteurs que de squats
Les squatteurs constituent une catégorie hétérogène. Ils investissent leur démarche d’enjeux très variés ou l’associent à des buts différents. Certains travaillent à côté, d’autres rénovent à temps plein. Même la littérature, inspirée d’histoires vraies, documente cette variété de configurations.
Des artistes ont besoin de plus d’ordre et d’espace, d’autres veulent avant tout des espaces collectifs. Le CAES, à Ris-Orangis en Île-de-France, la Gare XP ou le Jardin d’Alice, à Paris, en sont des exemples. Dans leurs opportunités de dialogue avec l’administration politique ou leurs stratégies de défense contre les menaces d’expulsion, plusieurs phases peuvent se succéder, depuis la recherche d’empathie, jusqu’à la résistance active (ici à Hambourg). Certains squatteurs organisent des journées portes ouvertes, ouvrent des cafés ou des espaces culturels autogérés, accessibles aux curieux, aux voisins et aux sympathisants.
D’autres donnent l’impression de consacrer une partie de leur temps à s’agacer que l’on montre une quelconque méfiance à leur égard. Certains squattent pour dormir, d’autres pour y rester. On peut vouloir partager un lieu à plusieurs et parfois espérer y vivre autrement. Certains vont chercher à aménager des espaces de travail, d’autres y verront même l’opportunité de créer de véritables coopératives. Il arrive qu’on s’installe pour sauver la maison, d’autres fois pour défendre le quartier.
Ce faisant, les squatteurs se révèlent des acteurs à part entière de l’histoire urbaine, et donc de la production spatiale.
Antoinette Brisset, surnommée la « Jeanne d’Arc des squatters » d’Angers (dans le Franc-Tireur du 6 février 1950), ne dit pas autre chose lorsqu’elle affirme, lors d’une conférence tenue à Paris en 1952 : « Squatter veut dire “servir”. S’ils les [squatteurs] ne servent pas toujours sous le drapeau que la morale de notre temps approuve, c’est que notre temps est en folie. ».
On peut se cacher dans un squat, et on peut y être précisément recherché. On s’y installe, on le fuit, on en change, on le déménage, on le défend, on l’aménage. On y vit, on y naît rarement, on y crée souvent, on y meurt parfois.
![]() On y dort, heureusement.
On y dort, heureusement.
La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation.